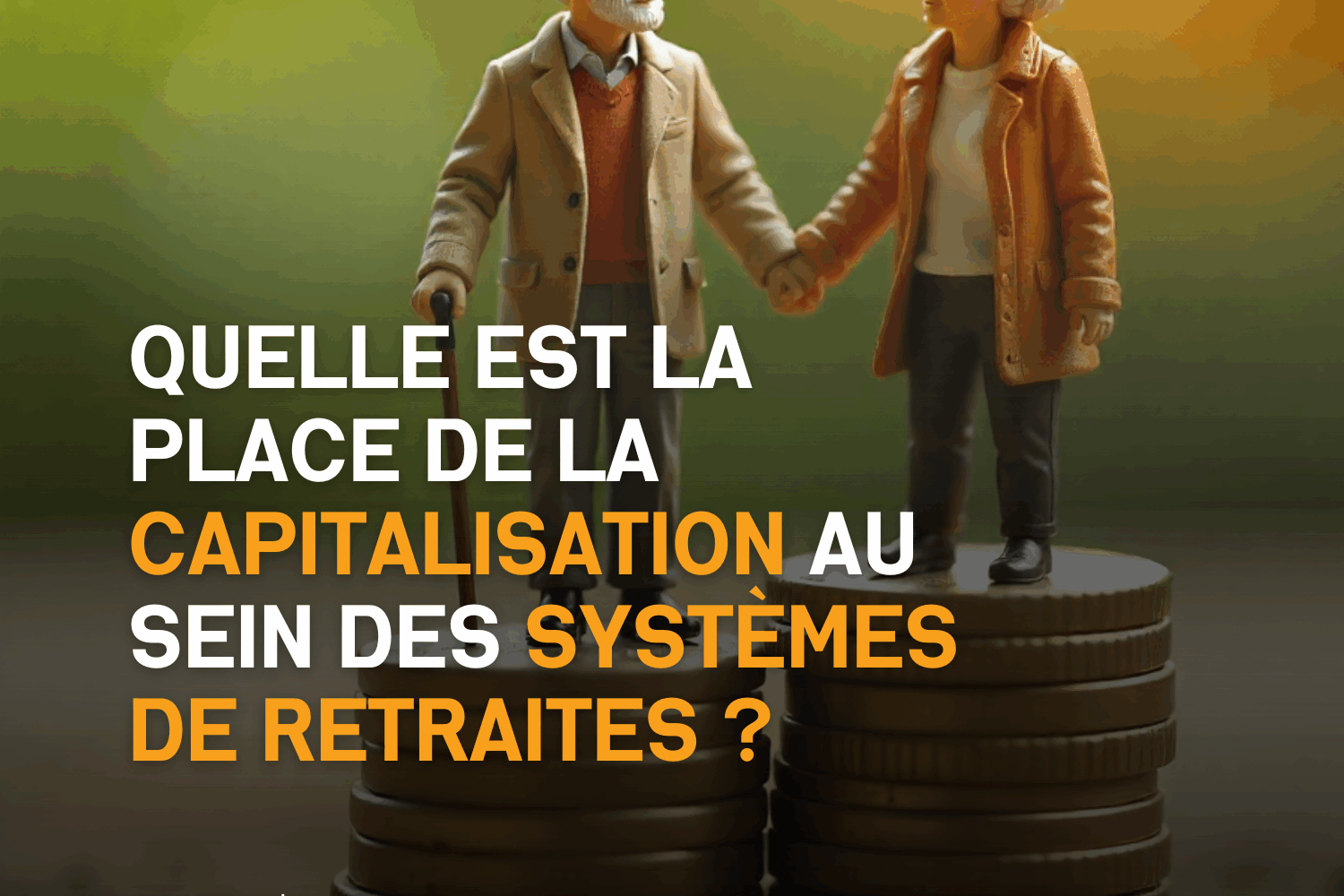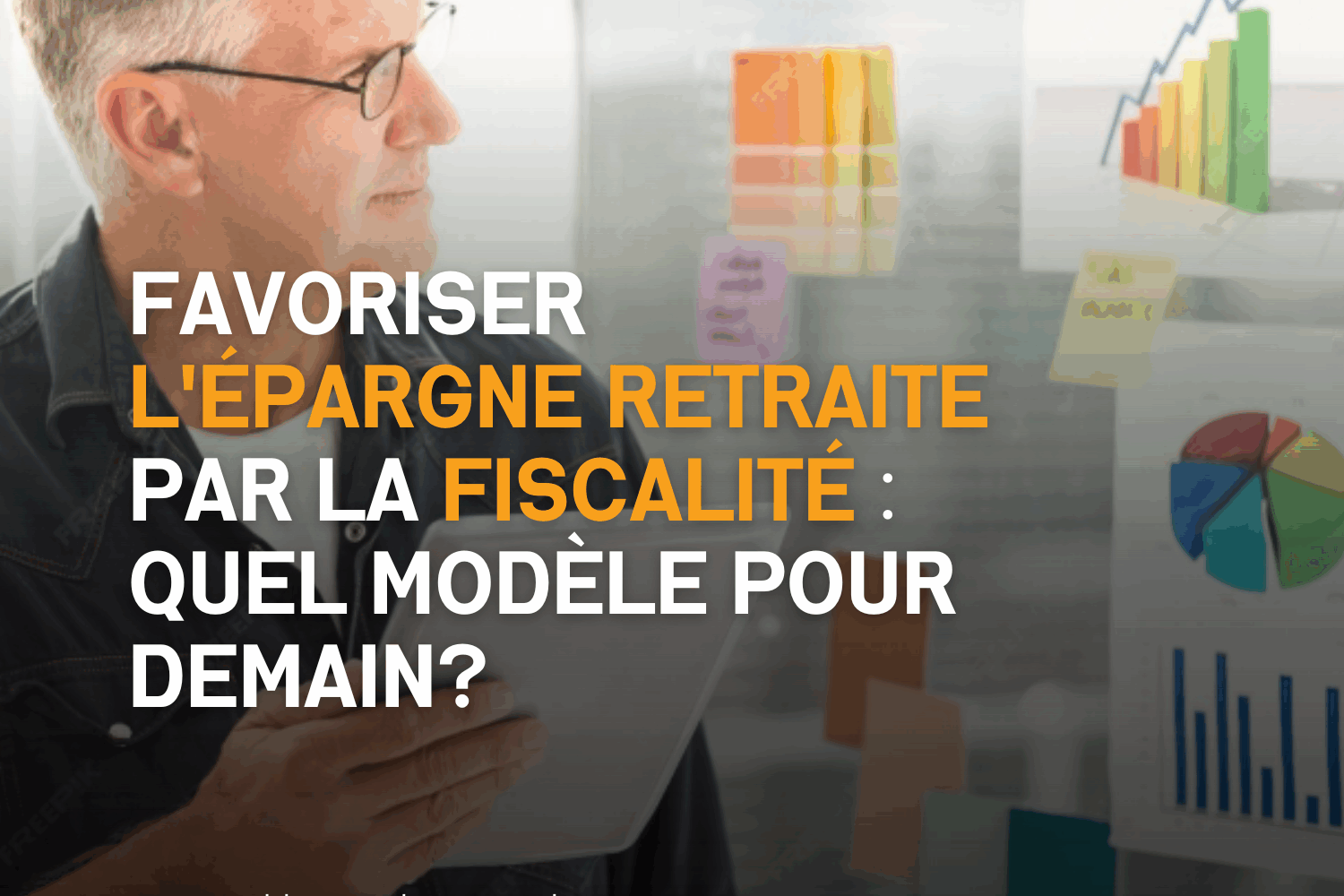- Accueil
- Articles
- Bâtir une société de cohésion intergénérationnelle
- Les différents visages de l’aidance : quelle(s) aidance(s) pour quel(s) impact(s) ?
Les différents visages de l’aidance : quelle(s) aidance(s) pour quel(s) impact(s) ?
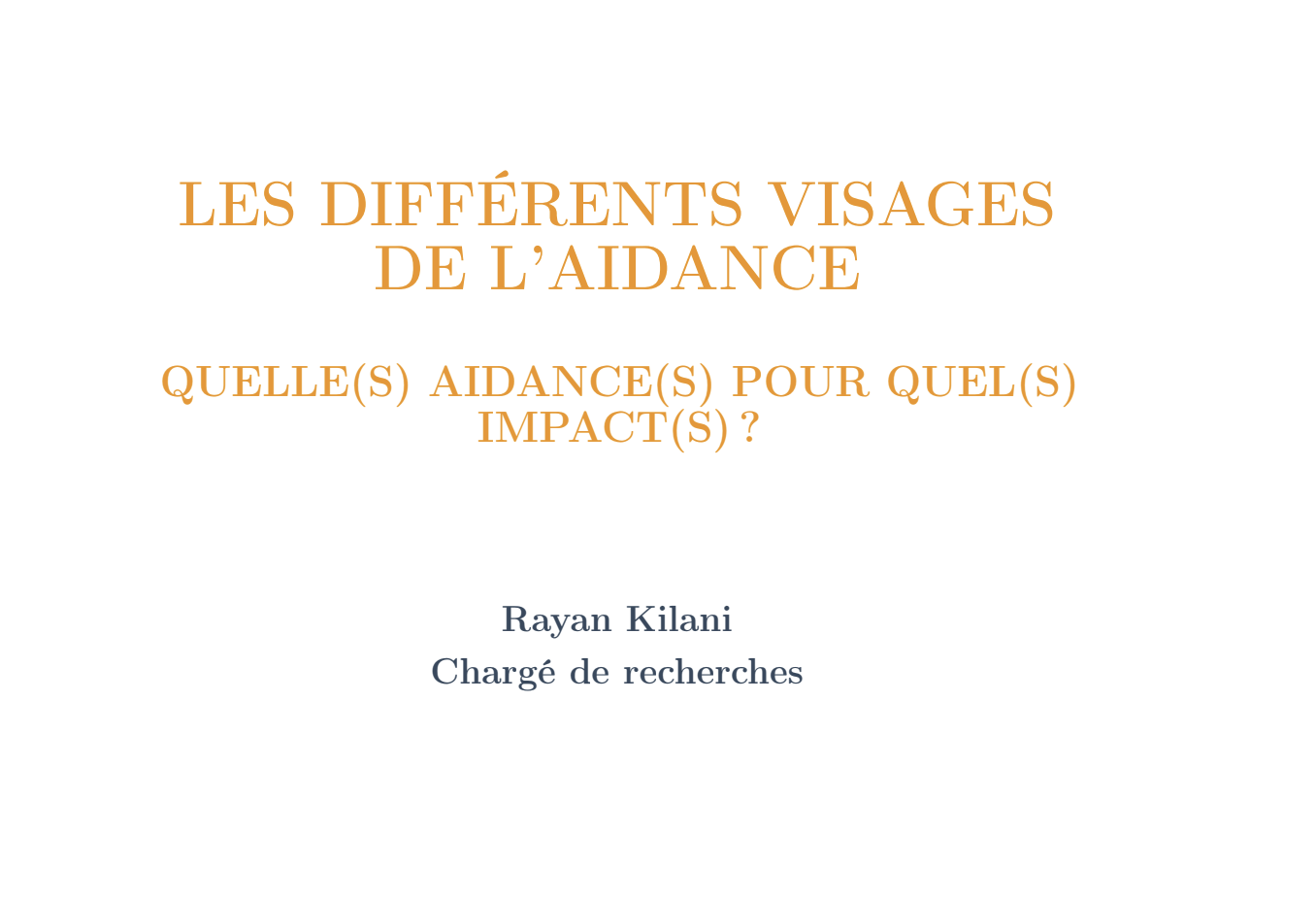
L’étude conduite ici par la Chaire TDTE met en lumière les nombreux défis auxquels sont confrontés les aidants, soulignant l’importance croissante de leur rôle dans un contexte de vieillissement démographique. Les résultats de cette recherche s’appuient sur l’analyse des données de l’enquête SHARE, permettant une compréhension approfondie des différents profils d’aidants, des impacts sur leur vie professionnelle, et des conséquences sur leur santé, sur la base de données fiables et accessibles à tous, et de méthodes sérieuses et innovantes.
L’analyse des profils d’aidants identifie trois groupes distincts : les aidants intensifs et intégrés, les aidants occasionnels et peu intégrés, et les aidants réguliers et vulnérables. Cette classification révèle la diversité des situations et des implications de l’aidance, allant d’une aide quotidienne, souvent prodiguée par des femmes actives et intégrées socialement, à une aide plus sporadique, apportée par des individus plus âgés et moins connectés à la vie professionnelle. Le troisième groupe, bien que fournissant une aide régulière, se distingue par sa vulnérabilité accrue, les aidants étant eux-mêmes souvent en mauvaise santé et éloignés de l’emploi. On voit donc émerger une structuration de l’aidance selon les axes de la fréquence et de l’intégration dans un tissu relationnel. L’impact de l’aidance sur la vie professionnelle est significatif, particulièrement pour les aidants quotidiens qui travaillent en moyenne cinq heures de moins par semaine que leurs homologues fournissant une aide mensuelle. Cette réduction du temps de travail se traduit par une perte économique non négligeable, estimée à environ 100 000 emplois à temps plein. Les aidants subissent en plus de cela d’importantes répercussion sur d’autres aspects de leur vie professionnelle. Ils connaissent plus souvent une rémunération plus faible, subissent des discriminations et voient leurs carrières et leurs progressions freinées.
Ces observations mettent en évidence le coût pour ces aidants, qui sacrifient une partie de leur revenu pour prendre soin de leurs proches. En ce qui concerne la santé des aidants, ces derniers voient un impact important de l’aidance sur leur propre état de santé pendant qu’ils occupent le rôle d’aidant, tout en modifiant leur propre perception de leur santé. L’étude souligne que l’entrée dans l’aidance accélère la dégradation de leur état de santé, particulièrement chez les retraités, plus vulnérables en raison de leur âge avancé. L’arrêt de l’aidance ralentit cette dégradation, bien que les retraités restent affectés de manière plus durable. L’étude met en avant les différences marquées entre les pays européens en termes de soutien aux aidants. Les pays nordiques, qui privilégient une plus grande externalisation des soins par le recours aux services professionnels, parviennent à mieux préserver la santé de leurs aidants. À l’inverse, les pays comme l’Italie, où le soutien professionnel est moins accessible, voient leurs aidants subir une dégradation de santé plus rapide.
En conclusion, cette étude souligne la complexité et la diversité des expériences d’aidance en France et en Europe, mettant en lumière l’impact profond de ce rôle sur la vie des individus qui l’assument. Les résultats suggèrent un besoin urgent de renforcer les politiques de soutien aux aidants, tant au niveau professionnel que sanitaire, pour leur permettre de concilier leurs responsabilités sans compromettre leur santé ni leur situation économique.