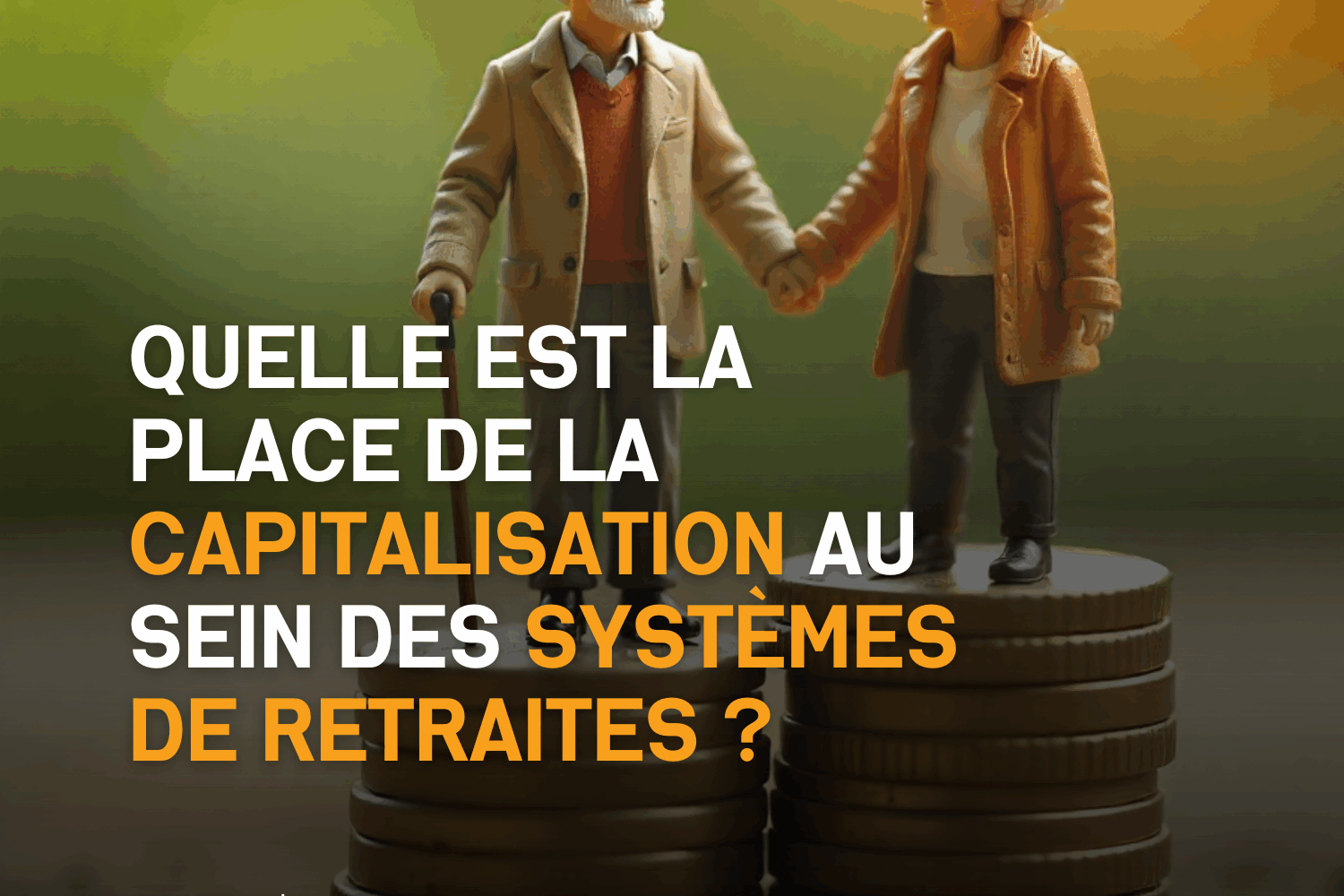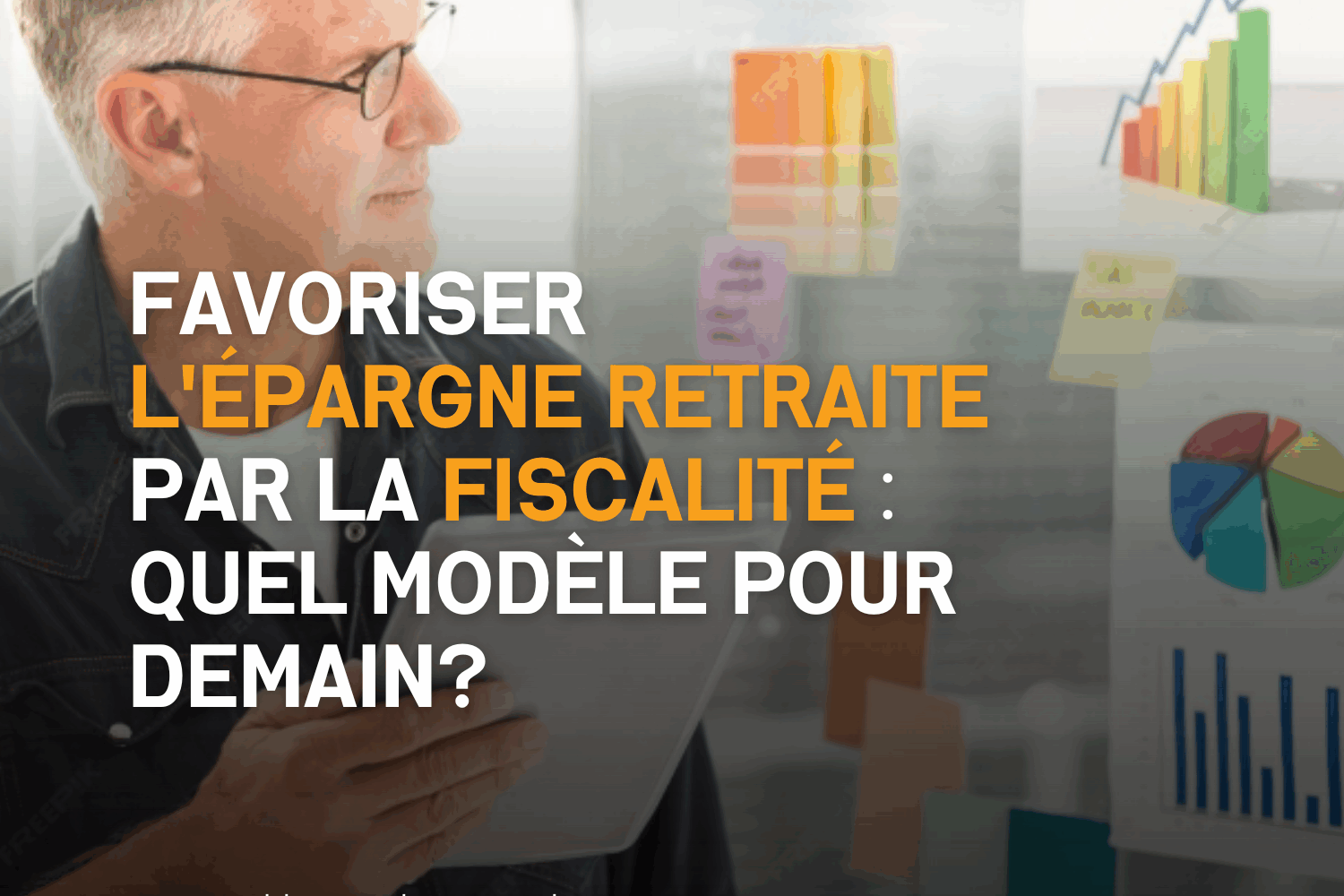L’épargne est un des concepts phares de l’économie, il correspond à la part des revenus qui n’est pas dépensé dans la consommation. Il existe différents types d’épargne qui ont des effets distincts sur l’économie. On trouve, d’une part, les placements sur des livrets bancaires (livret A, livret d’épargne populaire…) qui permettent principalement le financement de l’État et des collectivités pour la construction de routes, écoles ou autres infrastructures publiques… D’autre part, il existe les placements en bourses qui permettent le financement d’entreprises privées, offrant une alternative au crédit bancaire pour le développement du capital de ces entreprises et donc de leur activité.
Ces deux méthodes d’épargne sont considérées comme de l’épargne financière car elles consistent à faire fructifier des placements monétaires via des intérêts, mais il est aussi possible de se constituer une épargne non financière. Cette dernière consistera à acheter des biens physiques, tels que de l’immobilier, de l’art, ou encore des pierres précieuses qui ne perdront pas, voire gagneront en valeur dans le temps.
Sachant cela, le niveau d’épargne global est crucial pour un pays. En effet, l’épargne financière permet de financer les investissements pour le futur permettant ainsi le financement de
l’économie réelle. Il faut néanmoins faire attention à ce que ce niveau ne soit pas trop important, ce qui risquerait d’entraver la consommation et donc de nuire à l’activité économique. Pendant la
crise du coronavirus, le taux d’épargne1 des Français s’élevait à plus de 20%, les ménages avaient fortement réduit leur consommation et la croissance du pays à fortement ralenti. Au contraire, un niveau d’épargne trop faible va impliquer un niveau d’investissement trop bas ne permettant pas une croissance optimale du pays.
Outre l’implication macroéconomique, il est intéressant de regarder les comportements microéconomiques des agents vis-à-vis de l’épargne et leur évolution dans le temps. En effet, avec les différentes transitions que nous vivons, qu’elle soit numérique ou démographique, les comportements des agents ont fortement évolué. Les jeunes entrent (en moyenne) plus tard sur le marché du travail, l’espérance de vie (notamment en bonne santé) ne cesse de croître, les prix de l’immobilier augmentent de manière importante. Tout ceci ne sont que des exemples de phénomènes ayant des impacts sur les comportements d’épargne des agents, impacts qui changent drastiquement selon la génération prise en compte. L’objectif de cette note étant de montrer la nature de ces changements de comportements par génération, il sera nécessaire de définir la théorie du cycle de vie, telle qu’elle a été énoncée dans le milieu du 20ème siècle. Cela nous permettra, dans un premier temps, de définir les variables ayant un impact sur l’épargne des ménages et dans un second temps, de montrer les évolutions majeures (notamment dûes au choc démographique) que l’on peut observer selon l’âge des individus.
Lire l’étude