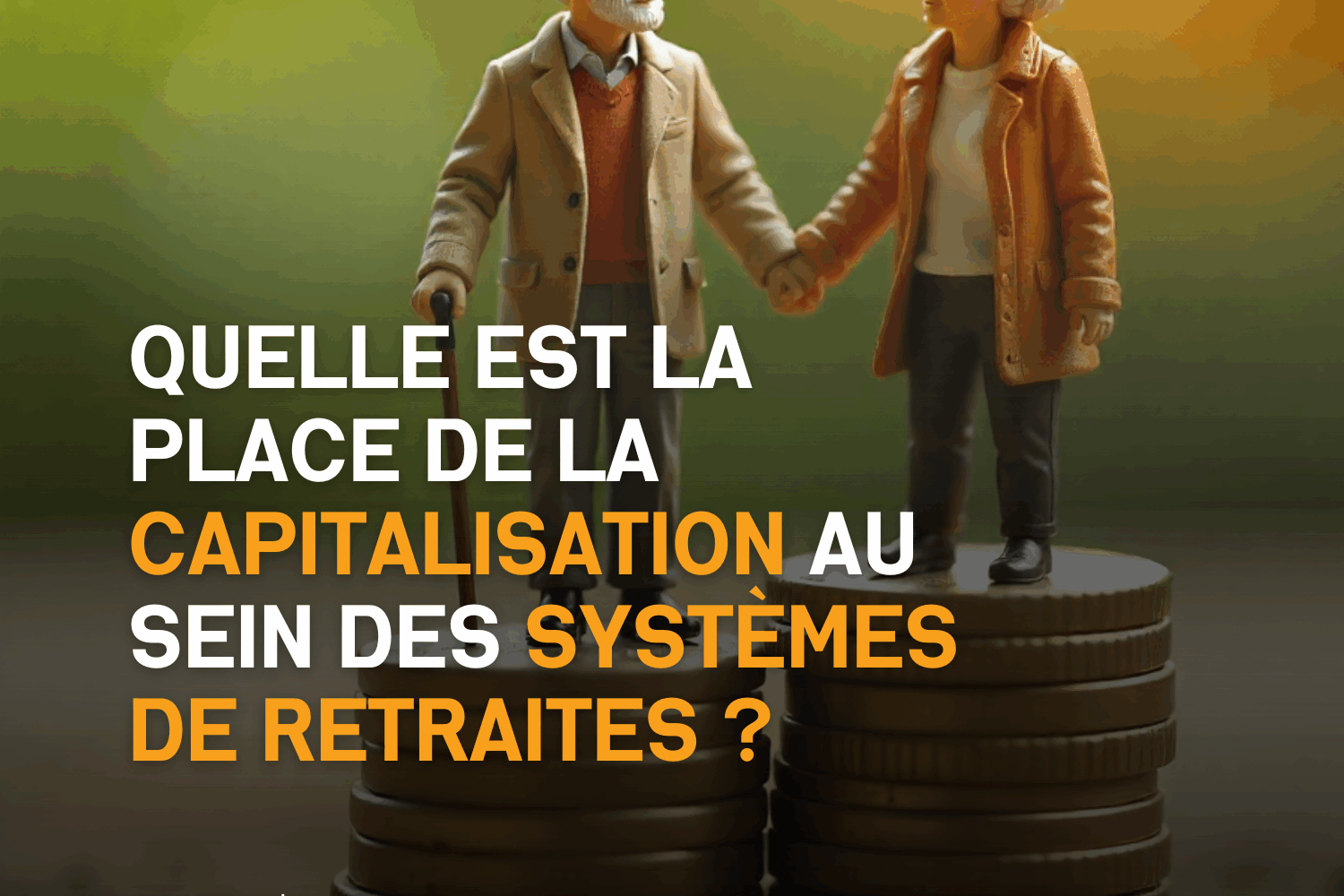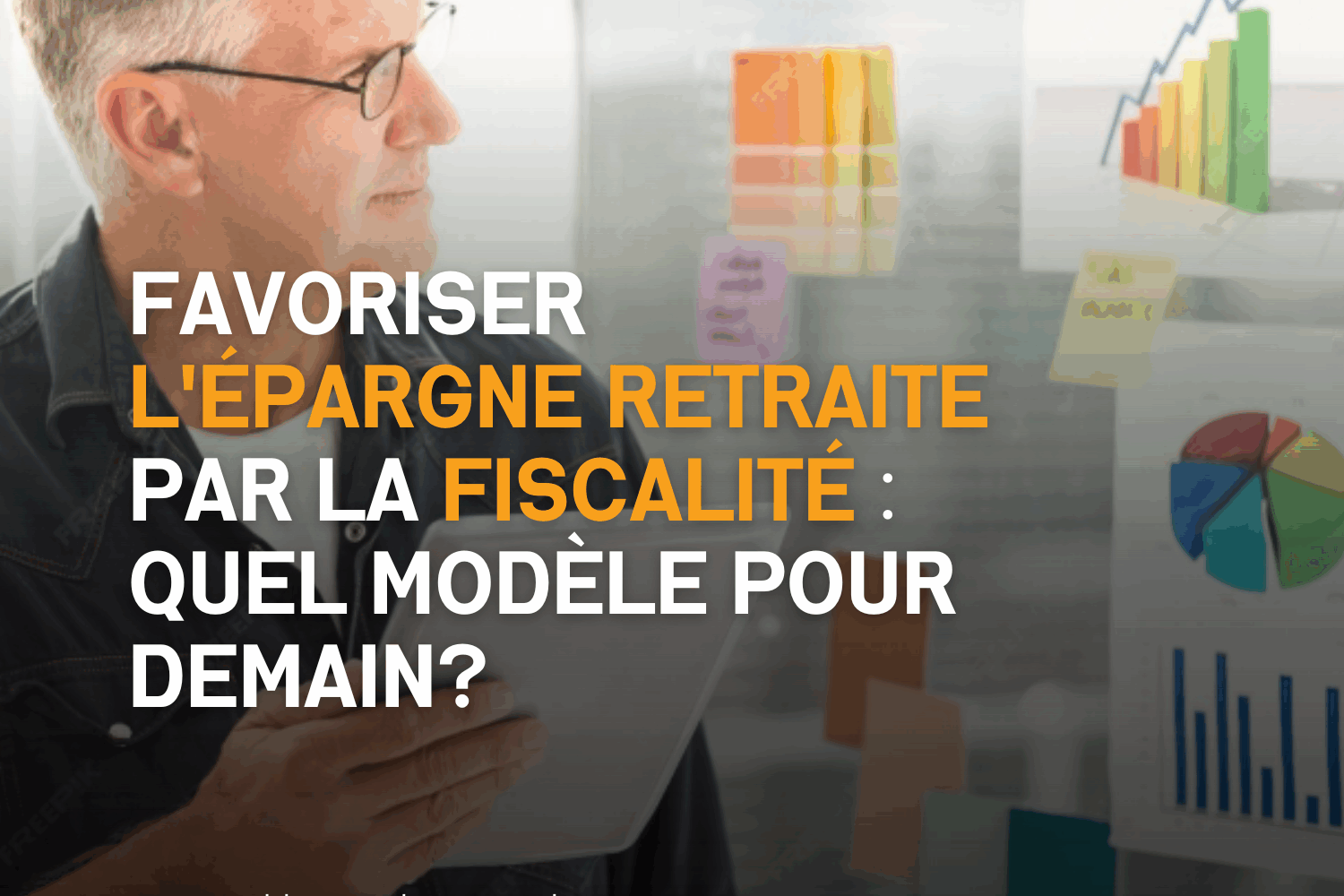Inégalités économiques entre générations en France
L’analyse économique actuelle fustige les inégalités intra et intergénérationnelles soulignant l’importance du rôle du capital des seniors. La règle des 3 fois 60 n’en est qu’un symptôme. Les 60 ans et plus détiennent 60% du capital financier et 60% du capital non financier en France. De plus, le poids des dépenses retraites vient exacerber ce ressentiment d’injustice au vue du niveau de vie de cette population alors que le pays souffre d’une crise majeure, causant incertitude et fragilité économique. Au regard de la générosité (relative) de notre système de retraite, les inégalités de revenus semblent principalement provenir de problèmes sur le marché du travail, créant inégalités salariales et oppositions inter et intra générationnelles. Les inégalités patrimoniales, surtout aux mains des seniors, sont fixés dans un schéma d’aversion au risque, de liquidité et d’investissement à court terme faiblement pourvoyeur de croissance, délaissant des investissements productifs socialement, écologiquement venant accroitre la croissance à long terme. Il faut donc chercher des perspectives de réduction des inégalités à travers des solutions d’épargne innovantes à l’adresse des seniors, luttant ainsi contre la patrimonialisation de notre société et visant des objectifs communs.
Comment réduire les inégalités entre générations ?
Cette redistribution pourrait revêtir deux formes, agissant par voix de vase communiquant, prenant à l’une pour donner à l’autre, ou, liant les générations par des incitations, contraintes fiscales ou institutionnelles. Un panorama d’idées sont évoquées allant de la réduction du poids des transferts aux générations ainées, d’une redistribution accrue envers les jeunes, d’un impôt général et progressif sur le patrimoine dotant les jeunes en capital, à une mutualisation des coûts additionnels de la dépendance des seniors. Toutes ces propositions semblent jouer sur l’allocation des dépenses publiques ou privées, mais des solutions de politiques du lien intergénérationnel existent. Par exemple, le principe de Musgrave d’un choix démocratique du ratio de pension moyenne au salaire moyen, l’indexation de la retraite sur des indicateurs de performance et/ou d’intégration des jeunes, ou encore une incitation à l’investissement d’avenir du patrimoine financier des seniors. Cette liste d’outils permettant de réduire les inégalités à la volonté d’agir dès demain et de lier les générations entre-elles, où chacun dépend du sort de chacun et amenant à une société harmonisée prospère.
Société harmonieuse entre générations : quelle définition, quels critères ?
Le concept d’une société harmonieuse entre générations se comprend assez bien intuitivement mais il est difficile de lui conférer une définition opératoire, forcément plus précise et réductrice. La position de Rawls et d’une solidarité transgénérationnelle avec une chaine de réciprocité indirecte, descendante et rétrospective reste une position prometteuse mais réductrice dans l’idée d’une définition formelle. La mise en place d’hypothèse minimale semble cohérent avec le jalonnement d’un parcours menant à une définition d’harmonie intergénérationnelle.
Hypothèse 1 : une société harmonieuse entre générations doit être une société équilibrée entre générations. Cet équilibre se joue à deux niveaux, celui longitudinal (les générations suivent à différentes dates des profils par âge comparables) et celui transversal (à une date donnée les générations sont dans une position comparable). Ces deux niveaux sont complémentaires : suivre le seul critère longitudinal pourrait mener à une société gérontocratique et stationnaire, suivre seul celui transversal ignorerait l’histoire différenciée des générations, et demande à y ajouter un critère de responsabilité collective de chaque génération envers les autres. Cette
première hypothèse permet d’identifier plusieurs critères d’harmonie entre générations : maintenir un ratio à peu près constant dans le temps entre les salaires et/ou patrimoines moyens à 30 ans et 50 ans ; maintenir constantes les parts du patrimoine global détenues par les différentes classes d’âge ; maintenir constant le ratio entre la pension moyenne et le salaire moyen net des cotisations retraite.
Hypothèse 2 : une société harmonieuse met chaque génération face à sa responsabilité collective. Ce concept peut conduire à des dérapages dangereux, il repose sur une solidarité arbitraire entre conscrits. Pour résoudre ce problème, plutôt qu’un contrat entre générations, il faut considérer des « contrats entre individus appartenant à différentes générations ».
Hypothèse 3 : une société harmonieuse entre générations repose sur une coopération équilibrée ou harmonieuse entre générations. Cette coopération est également double, longitudinale, optimale à l’équilibre de long terme, et transversale, qui lie les générations dans l’action présente et exerce notamment une « fonction de rappel » sur les seniors et les plus âgés.
Ainsi, alors que l’équilibre financier de la répartition demande donc beaucoup à la solidarité entre générations, l’harmonie entre générations devrait envisager une contribution significative du patrimoine des seniors qui peut se penser de deux manières. D’une part, des cotisations-patrimoine pour mutualiser le financement des dépenses d’hébergement liées à la perte d’autonomie. D’autre part, l’offre de placements financiers transgénérationnels, largement exemptés de droits de succession (par ailleurs accrus) pour financer les investissements publics d’avenir qui bénéficieront notamment aux générations jeunes et futures.
Hypothèse 4 : une société harmonieuse entre générations ne traite pas vraiment des réponses à des chocs de grande ampleur. L’harmonie entre générations reste un concept d’équilibre, pour traiter des chocs massifs qui fragilisent une société ou peuvent même remettre en cause sa survie, il faut faire véritablement faire appel à la solidarité entre générations.
Le thème d’une société inclusive, aux rapports équilibrés ou harmonieux, revient depuis quelques années face aux fragmentations de la société française. Il faut aller plus loin, dans une « société d’amitiés », à condition d’accorder au mot amitiés le sens que lui prête Aristote dans l’Ethique à Nicomaque, où elle y est conçue comme un ciment social avec ses multiples formes et gradations.
L’inclusion dans une société politiquement organisée fait tenir ensemble ces liens d’appartenance et donne une identité cohérente à l’individu. La réussite individuelle doit céder un peu le pas à la réussite collective et l’enjeu est de faire ou de refaire Nation (avant de faire éventuellement Europe) comme de reconstituer une chaîne solide de réciprocités directes et indirectes entre générations.
Lire l’étude