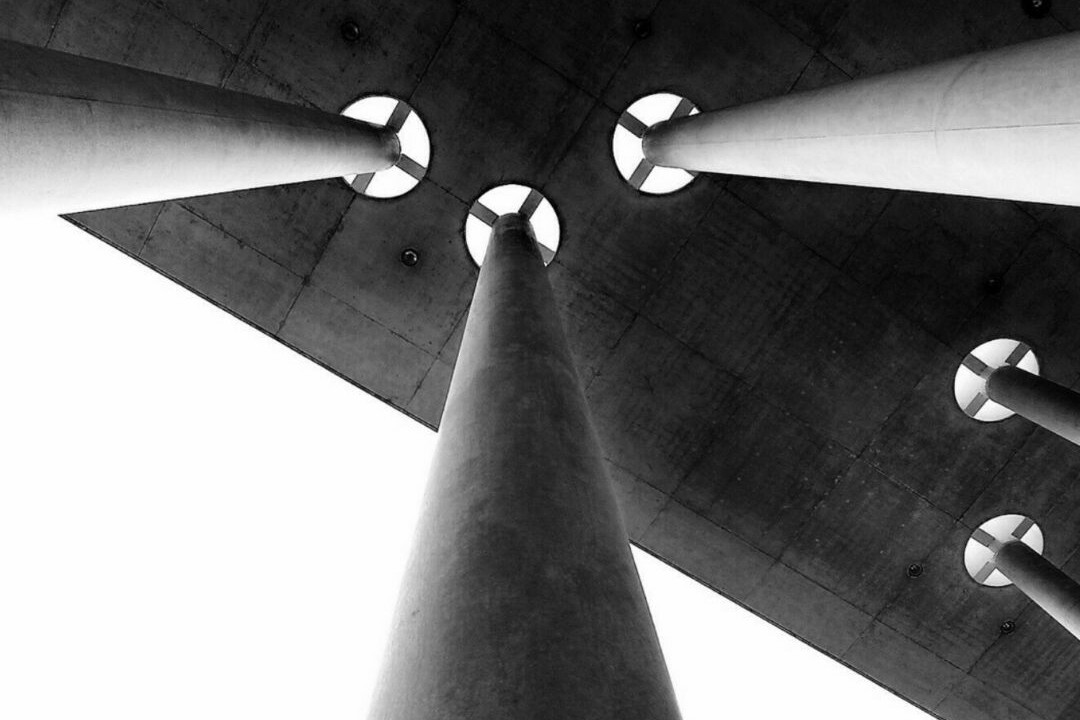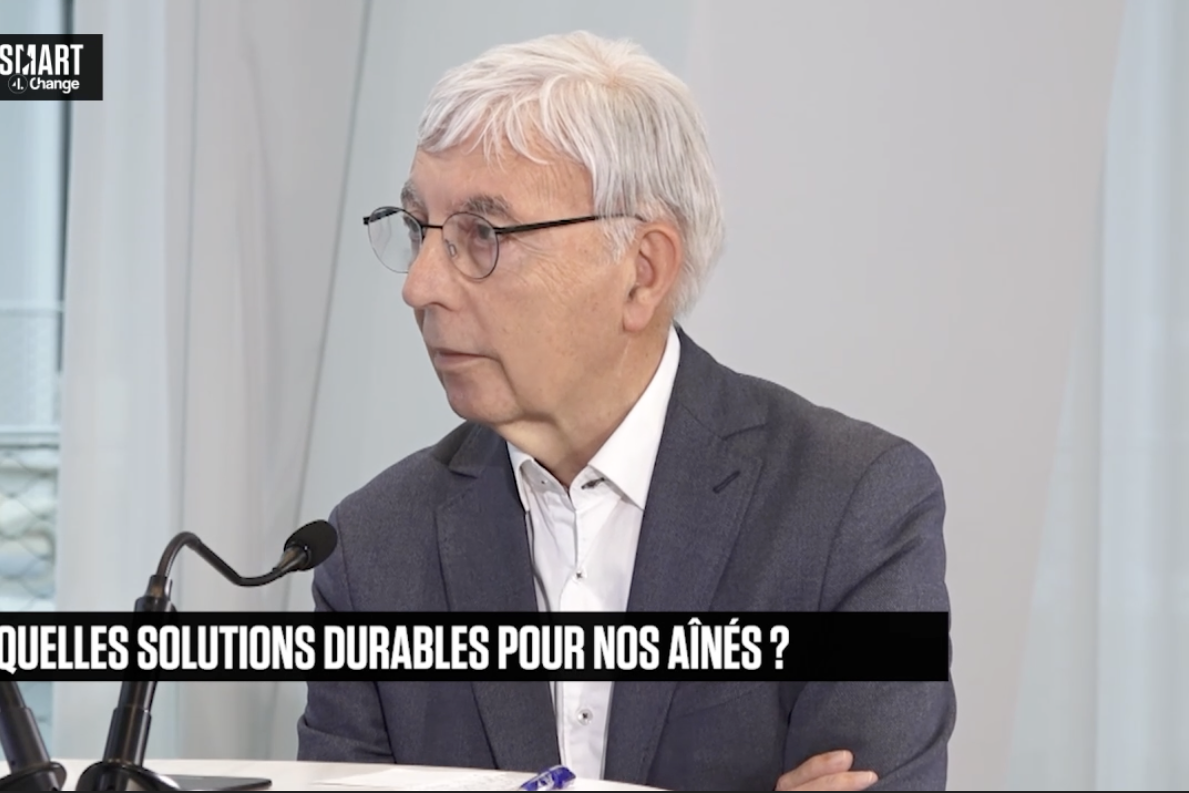- Accueil
- Choc démographique-le débat
- Retraites : « Toute nouvelle réforme doit reposer sur l’acceptation de l’allongement de la durée de vie active, de la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité »
Retraites : « Toute nouvelle réforme doit reposer sur l’acceptation de l’allongement de la durée de vie active, de la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité »

Une réforme juste, qui tienne compte des perspectives démographiques, doit passer par l’abandon de tout âge légal de départ en donnant la priorité absolue aux annuités, et par une plus grande attention à la réalité des retraités pauvres, expliquent dans une tribune au « Monde » les économistes Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur.
La réforme des retraites de 2023 a échoué sur deux fronts : elle a été perçue comme injuste et n’a pas résolu le déséquilibre financier du système. Pour tenter de surmonter ce double échec, laisser les partenaires sociaux se concerter sur une nouvelle réforme, sans intervention politique, était une bonne idée.
Mais, selon les travaux de notre chaire Transitions démographiques, transitions économiques, toute nouvelle réforme doit respecter certaines conditions. Elle doit reposer sur l’acceptation du choc démographique, de l’allongement juste et progressif de la durée de vie active, de la prise en compte réelle des carrières longues et de la pénibilité, accompagnée par l’amélioration des petites retraites. Le déséquilibre du système de retraite est d’environ 9 milliards d’euros en 2030. Nous affirmons que l’on peut rétablir l’équilibre à l’horizon 2030, dans le cadre d’un système plus juste, en se basant sur les préconisations qui suivent.
Il faut d’abord abandonner tout âge légal de départ à la retraite. Ceci ne conduit en aucun cas à renoncer à l’idée d’un âge plus tardif de départ, mais il convient d’aller dans ce sens de manière moins clivante et plus juste. Il faut donc donner la priorité absolue aux annuités.
Un système adapté de décote et surcote
Le maintien de 43 annuités requises en 2027 pour une retraite à taux plein, avec le système actuel de décote et de surcote, continuera à avoir un effet incitatif. Mais cela ne suffira pas pour assurer l’équilibre financier à terme. Nous préconisons donc d’augmenter les annuités requises pour atteindre 44 annuités en 2035, à raison d’un trimestre supplémentaire tous les deux ans à partir de 2027. Ceci semble tout à fait envisageable, car l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans est de dix ans et a progressé d’environ un an depuis les années 2010.
Bien sûr, il faut renforcer les incitations à rester en emploi avec un système adapté de décote et surcote, et il faut s’appuyer sur une politique plus volontariste des entreprises à garder leurs seniors, par exemple en augmentant les dépenses de formation et en améliorant les conditions de travail, avec un soutien public.
Ainsi, toutes ces mesures devraient induire dès 2030 un report de l’âge de départ à la retraite pour environ 300 000 personnes âgées de 55 à 64 ans, ce qui générera la création de richesses supplémentaires et des économies sur le versement des pensions.
Ensuite, pour une réforme plus juste, il faut réintroduire les quatre critères de pénibilité qui ont été écartés, tout en maintenant les dispositifs de carrières longues.
La pauvreté des femmes retraitées
Il faut en outre ouvrir les yeux sur une autre réalité : celle des quelque 600 000 seniors de 55-64 ans qui ne sont ni en emploi, ni au chômage, ni en retraite, sans avoir de problème de santé ou de handicap ; à ceux-ci, il faut rajouter 450 000 personnes au chômage à ces âges. Il doit être possible de réintégrer au marché du travail environ 100 000 de toutes ces personnes en 2030, moyennant l’effort déjà mentionné. L’effet bénéfique du taux d’emploi en sera grandi.
Les femmes sont particulièrement concernées par cette réalité, souvent obligées d’attendre l’âge de 67 ans pour toucher… une petite retraite. Cet âge de 67 ans est parfois justifié par la soi-disant comparaison avec l’Allemagne, alors que les Allemands partent en moyenne à 64,5 ans !
On touche là à un problème des plus douloureux, celui de la pauvreté des femmes retraitées ayant eu des carrières hachées et des salaires modestes. Une femme ayant eu une telle carrière, parfois à temps partiel (par exemple avec deux tiers de smic), aura une retraite mensuelle inférieure à 1 000 euros, ce qui ne permet pas de vivre décemment. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été augmentée ces dernières années, pour atteindre mensuellement environ 1 000 euros, mais elle est réservée aux personnes de plus de 65 ans.
La meilleure idée serait alors d’abaisser l’âge minimum d’obtention de l’ASPA, selon le nombre d’annuités. Pour les femmes pénalisées dans leurs carrières par la naissance et l’éducation d’enfants, et donc par un manque d’annuités requises, on doit mieux prendre en compte les enfants et leur permettre de bénéficier de l’ASPA.
Un rééquilibrage entre actifs et retraités
Compte tenu des mesures proposées, d’un montant d’environ 3 milliards d’euros en 2030, le besoin de financement serait alors de 12 milliards d’euros. L’augmentation des taux d’activité des seniors, qui nous ferait simplement rejoindre la moyenne européenne actuelle, ainsi que les pensions économisées devraient procurer des recettes de l’ordre de 9 à 10 milliards d’euros. Comment assurer alors l’équilibre ?
Tout cela suppose un léger rééquilibrage entre actifs et retraités. On peut imaginer mettre à contribution les retraités « aisés », ceux qui ont une pension mensuelle nette supérieure à 3 000 euros et qui sont propriétaires de leur logement, soit 20 % des retraités, avec la suppression de l’abattement pour frais professionnel de 10 %. Ceci devrait leur coûter en moyenne 800 euros annuels, soit autour de 1,3 % de leur revenu.
Au-delà, la réflexion doit s’engager pour un modèle soutenable des retraites. Le niveau de vie des futurs retraités va baisser dans les prochaines décennies par rapport à celui des actifs. De plus, les jeunes générations, perdant confiance dans le système actuel, sont favorables à une épargne individuelle afin de se procurer de futurs revenus.
Aussi, nous préconisons la création d’un fonds de capitalisation collectif délivrant une future pension supplémentaire aux retraités, tout en rassurant les jeunes générations sur l’avenir du système de retraite. Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 2001, pourrait jouer ce rôle à l’avenir.
Partager :
Articles liés
12 février 2025
Les 7 piliers d’une réforme réussie des retraites
par Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur et Kevin Genna
10 février 2025
Quelles solutions durables pour nos aînés ? – B SMART 4 CHANGE
Le 10 février 2025 avec Alain Villemeur( Directeur scientifique de la chaire TDTE), Eric Fregona (directeur adjoint, AD-PA) et Mathilde…
3 février 2025
Lettre de la Chaire TDTE au monde de l’Economie et de la Politique
par Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur et Kevin Genna