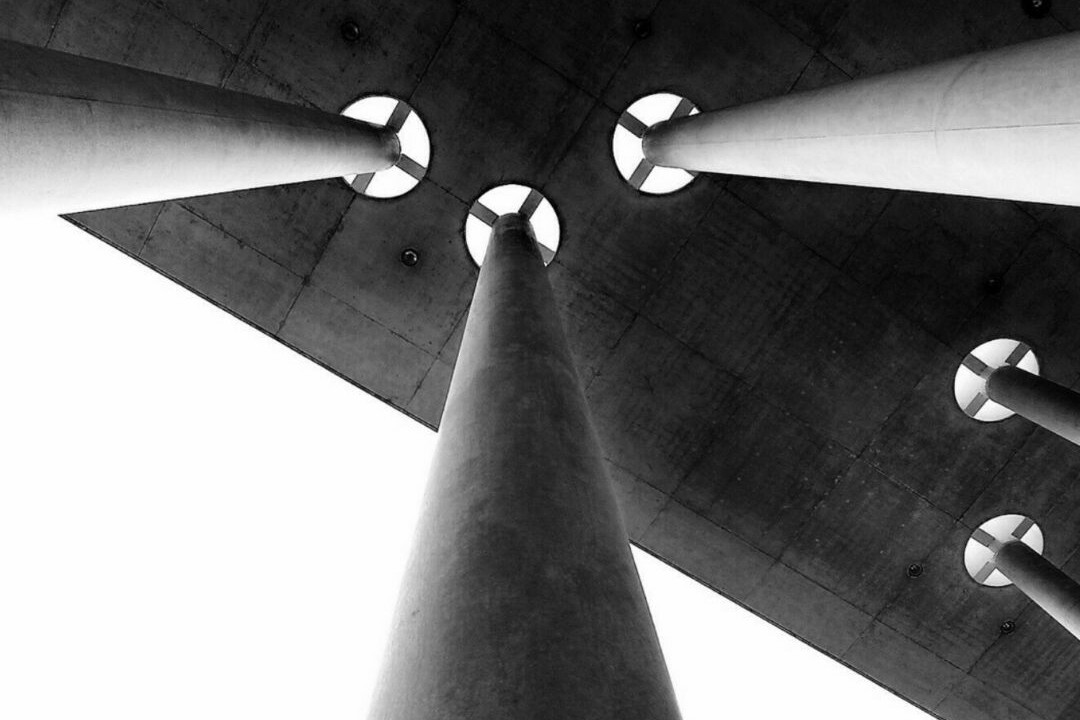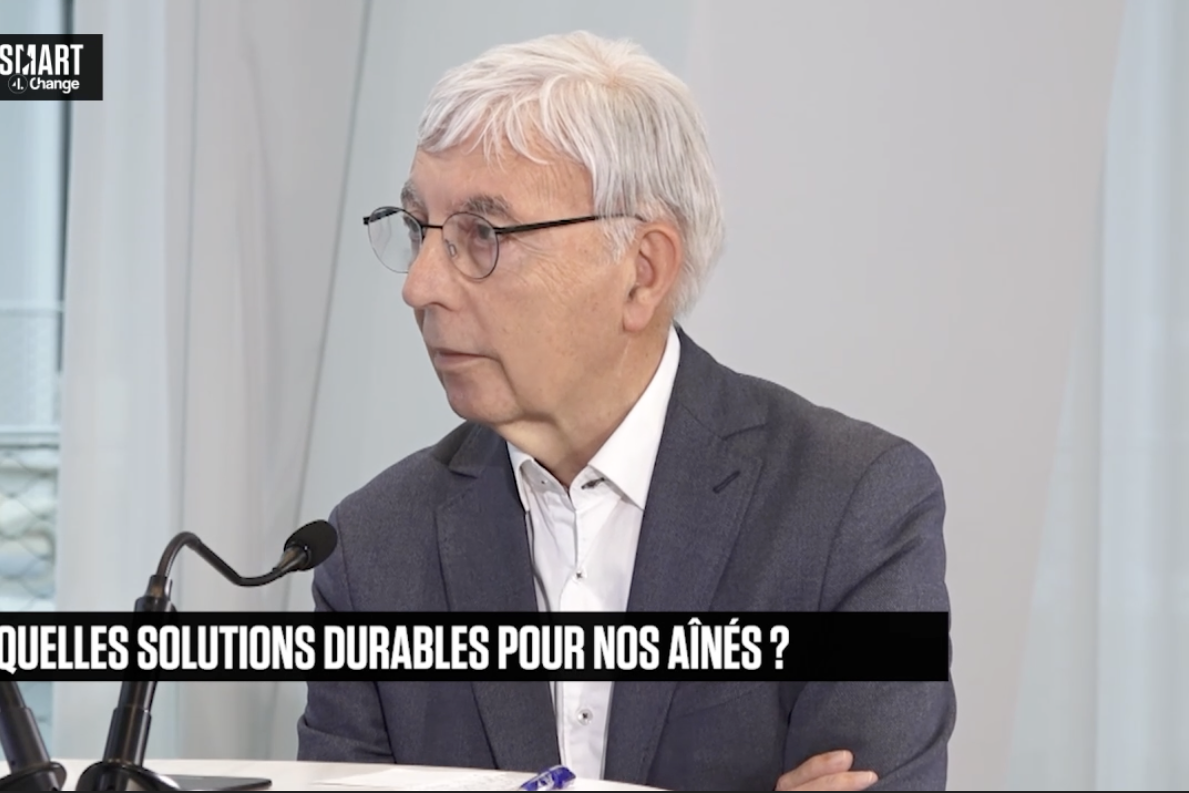- Accueil
- Choc démographique-le débat
- Pour « un donnant donnant » entre les générations – Le Monde
Pour « un donnant donnant » entre les générations – Le Monde

Le 28 mars 2017
LES VOIX DE L’ECONOMIE. Le contrat social français a oublié que jeunes et vieux n’ont pas les mêmes intérêts. Un nouveau compromis doit être trouvé, explique le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, dans une tribune au « Monde ».
« Pour la première fois cette année, à travers le débat présidentiel, cette question de la jeunesse est posée, bien que ses prémices soient apparues dès 1968, lorsque la jeunesse s’était révoltée contre des modes de vie qui lui semblaient trop contraints »
TRIBUNE. Inlassablement, les gouvernements français se succèdent avec toujours en leur sein un ministère baptisé alternativement « jeunesse » ou « jeunesse et sports ». L’idée est simple, il faut tenter de développer une politique spécifique pour les moins de 25 ans, politique qui se résume traditionnellement à psalmodier sur l’intégration de la jeunesse dans le monde du travail, dans le monde de la politique et même dans le monde du sport.
N’ayons pas la cruauté de rappeler ces chiffres si impressionnants du taux de chômage des jeunes, de leurs difficultés à se loger, de leur rejet de la politique. Tout cela est très connu, parfois excessif lorsque l’on parle de la génération sacrifiée. Surtout, cela part d’une idée fausse selon laquelle on peut traiter de ce problème en isolant une partie de la population sur un critère exclusivement générationnel. Même s’il est partiellement vrai de parler de génération sacrifiée, c’est oublier que les différentes générations, qu’on le veuille ou non, sont en compétition entre elles pour les revenus, le bien-être et la sécurité.
Mais cet aveuglement n’est pas qu’une simple erreur technocratique. La réalité est que nous vivons dans une société qui fonde son développement sur l’idée d’un contrat social. Cette idée est très ancienne, puisqu’elle est née avec John Locke, Thomas Hobbes et, bien entendu, Jean-Jacques Rousseau.
Seul pays d’Europe ayant une forte natalité
Elle a connu bien des pérégrinations, mais solide comme un roc, elle s’est définitivement installée depuis le milieu du XXe siècle dans tous les pays développés, avec la volonté de protéger les individus des accidents de la vie. Ce contrat social est aujourd’hui intimement lié au fordisme, à la production et à la consommation de masse, au développement de classes moyennes, à l’accès de tous à la santé et à l’éducation, du moins en théorie. Mais cette vision du monde ne fait jamais apparaître l’intergénérationnel : il n’y aurait ni jeunes ni vieux, seulement des citoyens.
En France, le contrat social, concrétisé par le Conseil national de la résistance, est devenu une icône de notre République. Mais, pas de chance, la France est demeurée le seul pays d’Europe ayant une forte natalité, et dont la talentueuse jeunesse fait l’objet de discriminations intragénérationnelles, de bipolarisation du niveau des qualifications, et donc de problèmes spécifiques.
Heureusement, pour la première fois cette année, à travers le débat présidentiel, cette question de la jeunesse est posée, bien que ses prémices soient apparues dès 1968, lorsque la jeunesse s’était révoltée contre des modes de vie qui lui semblaient trop contraints.
Un accord intergénérationnel
Mais aujourd’hui, le problème resurgit, non pas sous une forme marginale, comme ce fut le cas ces dernières décennies, mais en pleine lumière, peut-être parce que le système éducatif paraît à bout de souffle, incapable d’amener cette jeunesse à un niveau de formation adapté au marché de l’emploi. Cette crise profonde, c’est celle de l’incapacité de remplir le rêve républicain français, de faire fonctionner l’ascenseur social.
Alors, l’évidence apparaît. Il faut non pas substituer au contrat social historique un contrat fondé exclusivement sur un accord intergénérationnel, mais l’enrichir, le transformer, en y intégrant une dimension intergénérationnelle. Cela suppose d’établir avant tout entre les générations des compromis qui permettent à chacun de voir ce qu’il peut céder de ses avantages existants pour garantir des sécurités nouvelles dans les années à venir.
Prenons un exemple emblématique, celui des retraites. Chacun sait que les niveaux des pensions vont baisser de manière importante en raison des quatre réformes de retraites engagées depuis celle dite « Balladur » en 1993. Chacun sait également que l’immense majorité des jeunes ne croit pas à la pérennité du régime par répartition.
Compléter les dispositifs existants
Il y a donc là un terrain naturel d’accord entre générations, pour établir définitivement, peut-être même constitutionnellement, le régime des retraites par répartition, tout en donnant en contrepartie aux seniors la garantie d’une diminution moins forte et moins automatique de leur niveau de vie pour les vingt ans qui viennent.
Pour cela, il existe des solutions, au-delà des réformes d’harmonisation des régimes de retraites, notamment par points. Si l’on veut atteindre ces deux objectifs, il faut compléter les dispositifs existants par un régime collectif de retraites par capitalisation, comme par exemple le Fonds de réserve pour les retraites. Cette proposition permettrait d’équilibrer les intérêts de tous les âges et surtout de donner à chacun le sentiment qu’il y a bien eu un donnant-donnant.
Ce qui peut être fait pour les retraites peut l’être pour la santé où, là encore, les intérêts des différentes générations ne sont pas identiques : il faut un donnant-donnant. Même chose pour la formation et pour le marché du travail, où il s’agirait plutôt d’une alliance entre jeunes et vieux actifs face aux actifs de 30 ans à 50 ans, puisque ce sont les deux extrémités de la pyramide des âges qui sont dans ce domaine les plus maltraitées.
Jean-Hervé Lorenzi (Le Cercle des économistes)
Partager :
Articles liés
12 février 2025
Les 7 piliers d’une réforme réussie des retraites
par Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur et Kevin Genna
10 février 2025
Quelles solutions durables pour nos aînés ? – B SMART 4 CHANGE
Le 10 février 2025 avec Alain Villemeur( Directeur scientifique de la chaire TDTE), Eric Fregona (directeur adjoint, AD-PA) et Mathilde…