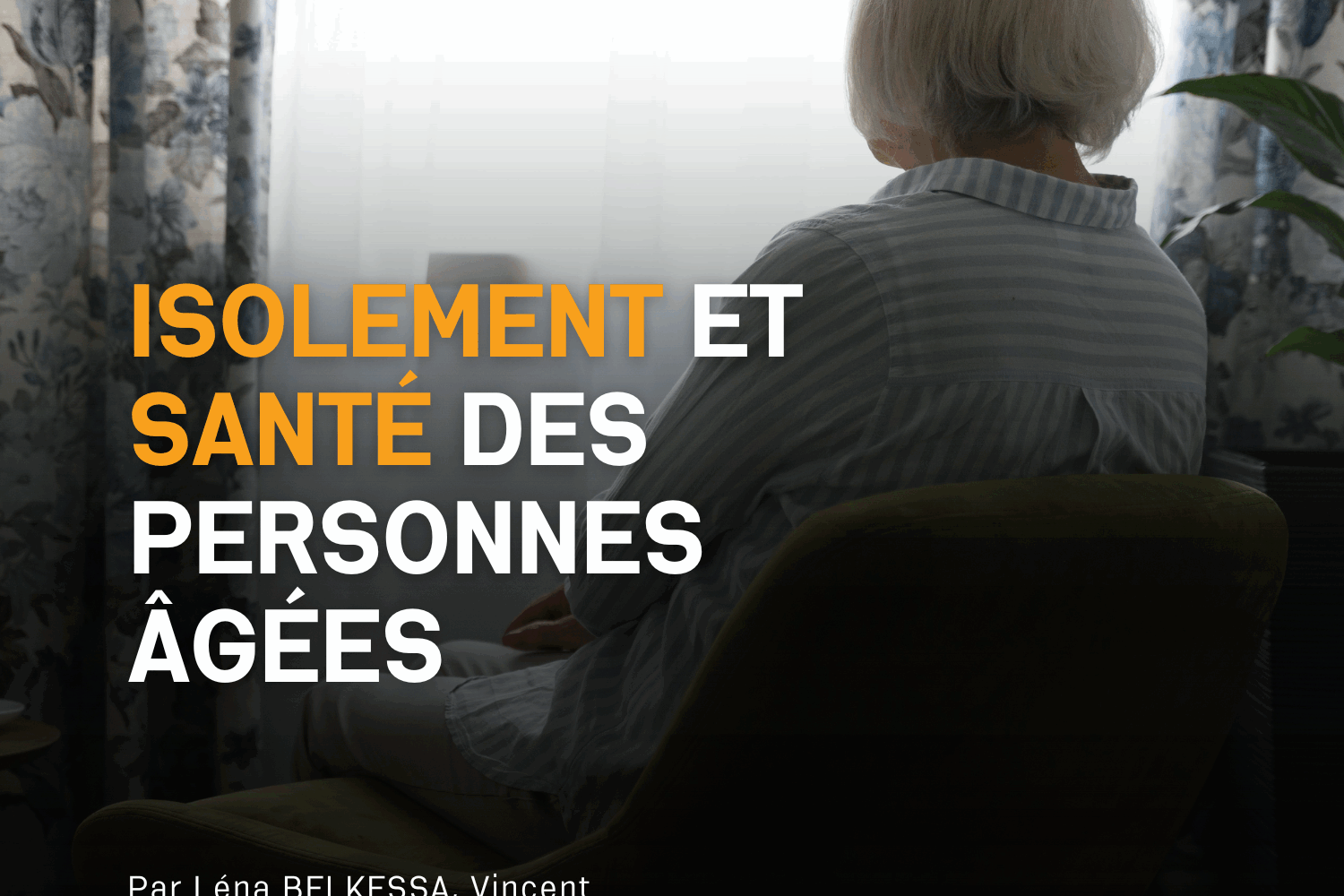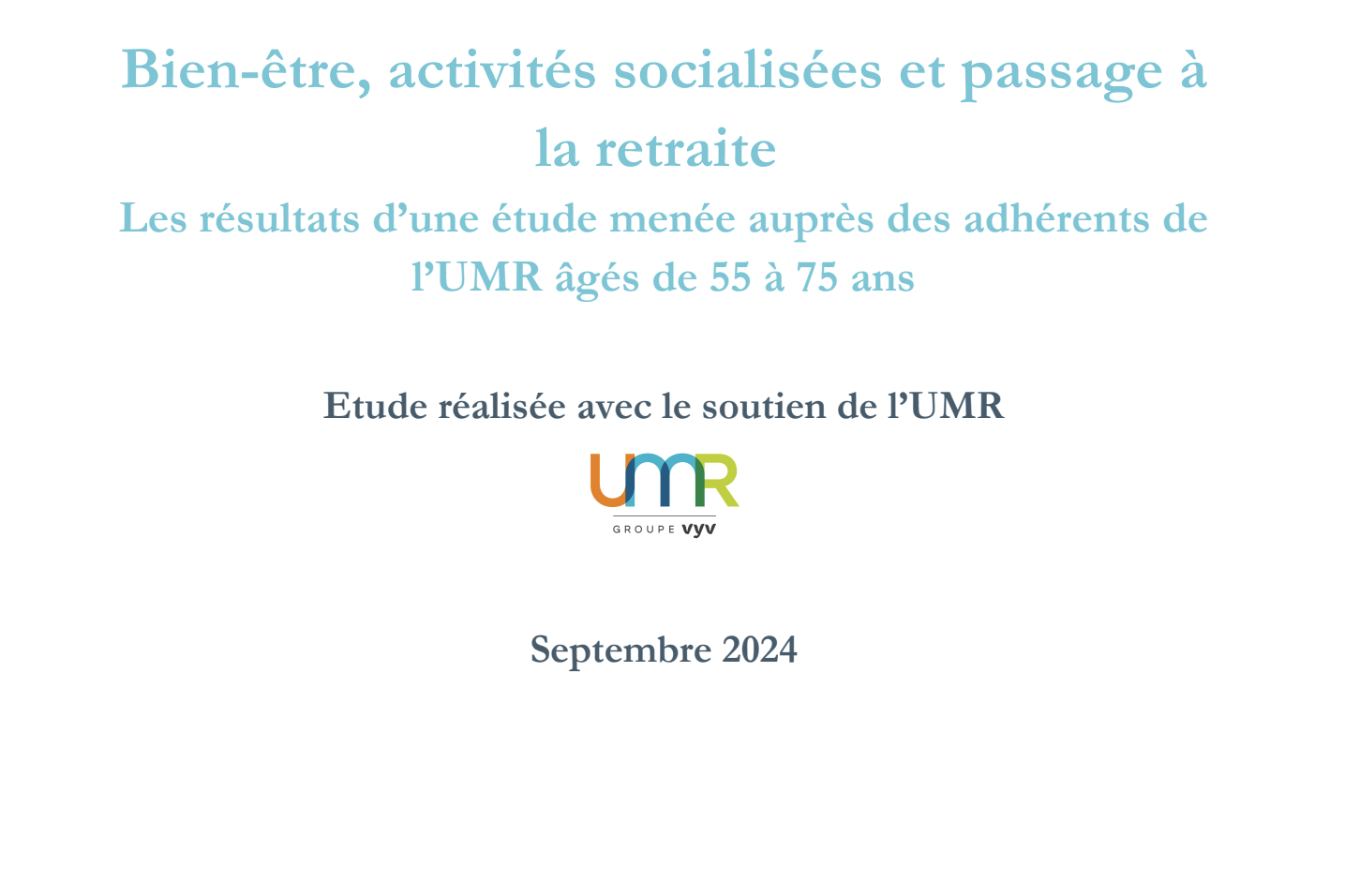- Accueil
- Articles
- Proposer des politiques pour le grand âge
- La prise en charge de la perte d’autonomie : réflexion historique et perspectives d’évolution
La prise en charge de la perte d’autonomie : réflexion historique et perspectives d’évolution
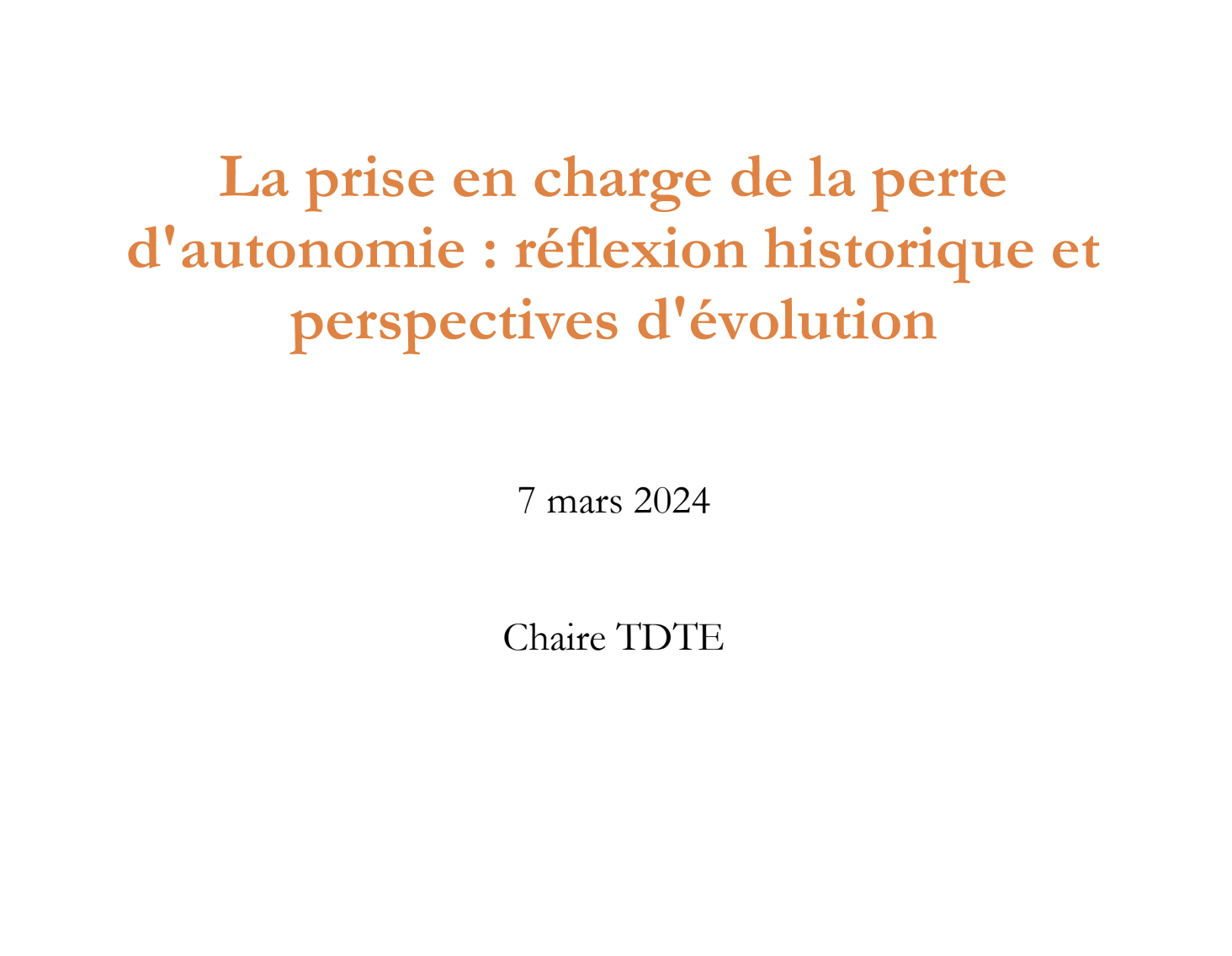
Par Lucien Saudubray, Chaire TDTE
La manière dont la société a pris en charge ses aînés a pris différentes formes au fil des siècles. À l’époque médiévale et sous l’Ancien Régime, la prise en charge s’effectuait à travers une sociabilité primaire, c’est-à-dire « qui lie directement les membres d’un groupe sur la base de leur appartenance familiale, de voisinage, de travail, tissant des réseaux d’interdépendance sans la médiation d’institutions spécialisées ». Cette prise en charge était également assurée par des institutions religieuses, incarnant la « charité chrétienne». Les quelques institutions laïques qui s’occupaient des vieillards, telles que les dépôts de mendicité ou l’hôpital général, obéissent plutôt à une logique de mise à l’écart des indésirables plutôt que d’une véritable politique de gestion de la perte d’autonomie. Les images et représentations de la vieillesse étaient alors ambivalentes, mais principalement associées à la dégradation et à la répugnance du vieillard.
La Révolution française marque une rupture dans la représentation et la prise en charge des aînés, avec l’apparition de la notion de « dette sociale », définie comme l’obligation de l’État d’offrir assistance à « ceux qui, à cause de l’âge ou des infirmités, sont privés des moyens de subvenir à leurs besoins par le travail ». Les représentations de la vieillesse sont revalorisées, s’inspirant notamment des images antiques.
La Troisième République permet l’établissement d’une solidarité républicaine envers les personnes âgées, remplaçant la charité chrétienne. Les débats autour de « l’invalidité ordinaire » mènent à une assistance sociale obligatoire et nationale, reprenant le concept de « dette sociale » de la Révolution. La vieillesse des plus pauvres et la prise en charge de l’invalidité deviennent des sujets d’intervention de la collectivité. La création d’une assurance vieillesse basée sur la capitalisation est instaurée dans les années 1930. Cette même époque marque par ailleurs « l’âge d’or des hospices », où la qualité de vie dépasse celle de la plupart des individus.
Après la Seconde Guerre mondiale, le régime général de la sécurité sociale, système hybride, est créé et prend en charge de manière universelle un ensemble de risques, notamment celui de la vieillesse. L’apparition du « troisième âge » et la décohabitation des générations conduisent les hospices à évoluer en « hospices pour vieux ». Le rapport Laroque de 1962 pointe les défaillances de ces hospices, dont les conditions se dégradent. Une transition est alors amorcée pour repenser le lieu d’accueil, avec l’apparition des foyers-logements en 1957 et la longue conversion des hospices en maison de retraite puis en EHPAD de 1975 à 2002. Ces dernières années ont été témoins de ruptures structurelles qui ont modifié notre conception de la prise en charge des aînés. La mise en place de l’APA en 2001 a facilité la prise en charge de la perte d’autonomie grâce à une aide financière permettant de couvrir les dépenses nécessaires notamment au maintien à domicile. La création du cinquième risque en 2020, géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a permis de reconnaître officiellement l’autonomie comme une composante à part entière de la sécurité sociale. La reconnaissance progressive des aidants a marqué une rupture significative en officialisant le rôle indispensable des proches dans l’accompagnement des personnes âgées.
Enfin, le scandale Orpea a conduit à questionner le débat public sur la pertinence de la quête permanente du profit dans la prise en charge de nos aînés. Les débats actuels sur la loi du Grand Age nous invitent à replacer cette question dans le temps long et à la mettre en relation avec les importantes ruptures en cours induites par la transition démographique. La nécessaire réforme ambitieuse de la prise en charge de la perte d’autonomie exige des moyens proportionnels au défi du vieillissement de la population. Les ruptures institutionnelles telles que la création du CNSA et de la cinquième branche constituent des outils pertinents pour appréhender cette transition, mais nécessitent davantage de moyens financiers. Le scandale d’ORPEA a entraîné une rupture dans la gestion des établissements d’accueil. Les EHPAD se tournent désormais vers des logiques plus humaines et inclusives. La mise en place de l’APA a marqué une rupture importante dans l’offre d’aide pour le maintien à domicile et pour permettre un vieillissement autonome chez soi. Cette évolution correspond au souhait d’une grande majorité des Français et nécessite donc d’être financée de manière plus conséquente. Enfin, la rupture légale que représente la reconnaissance des aidants est une étape cruciale qui doit être complétée par un plus grand soutien aux aidants et à leurs droits.
Partager :
Articles liés
14 septembre 2024
Bien-être, activités socialisées et passage à la retraite
Par La Chaire TDTE, UMR et CEPREMAP