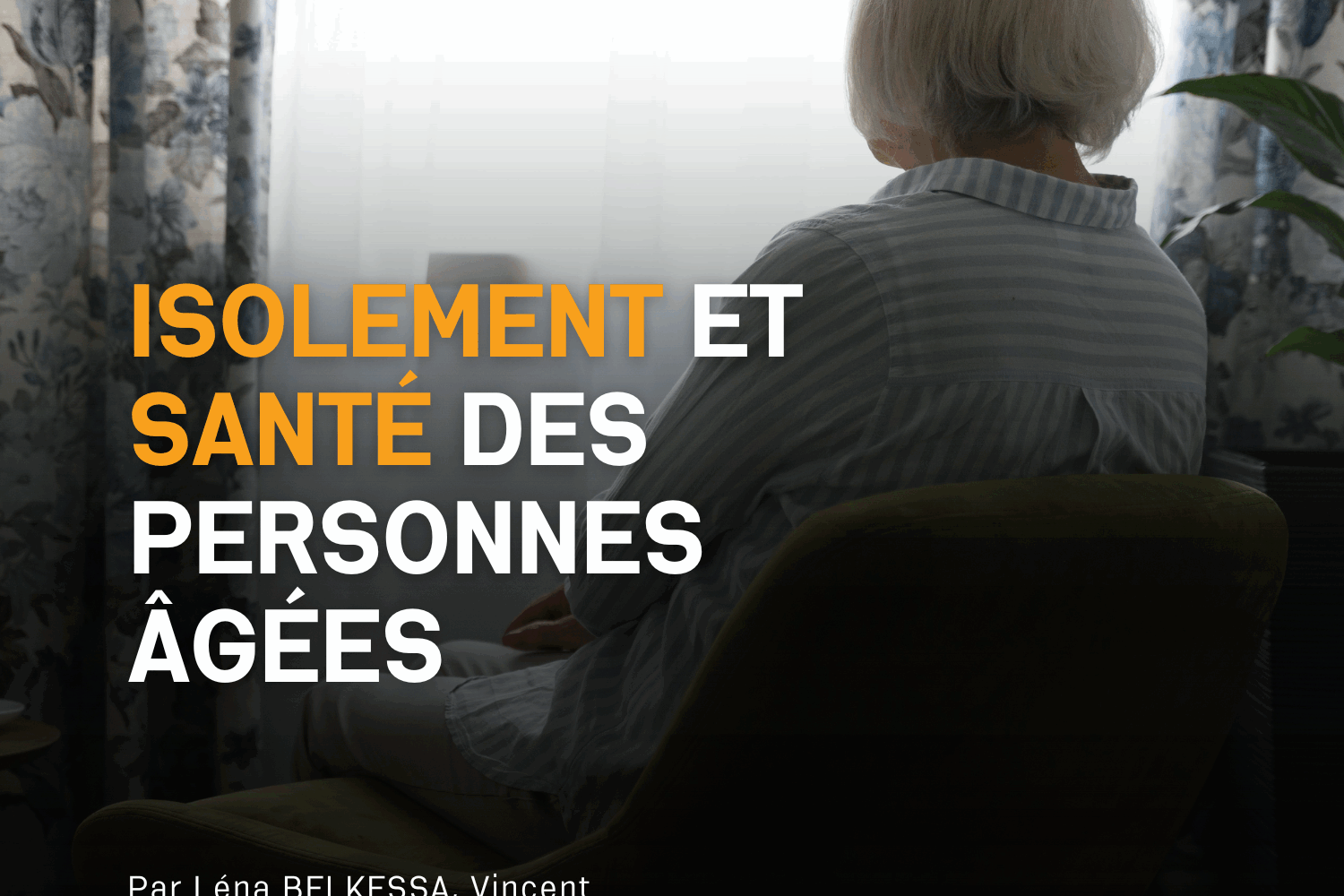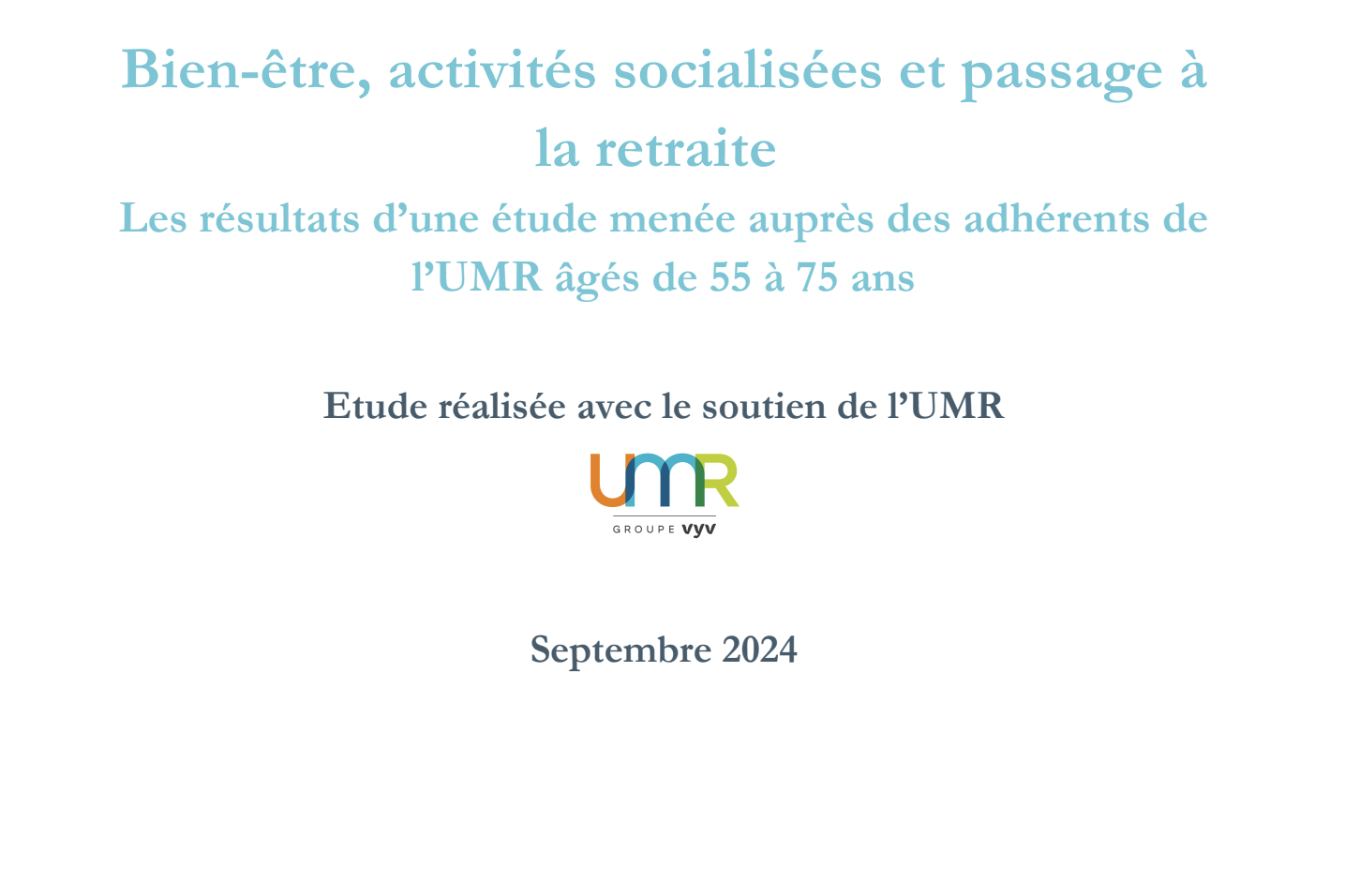- Accueil
- Articles
- Proposer des politiques pour le grand âge
- Comment repousser l’âge d’entrée en dépendance
Comment repousser l’âge d’entrée en dépendance
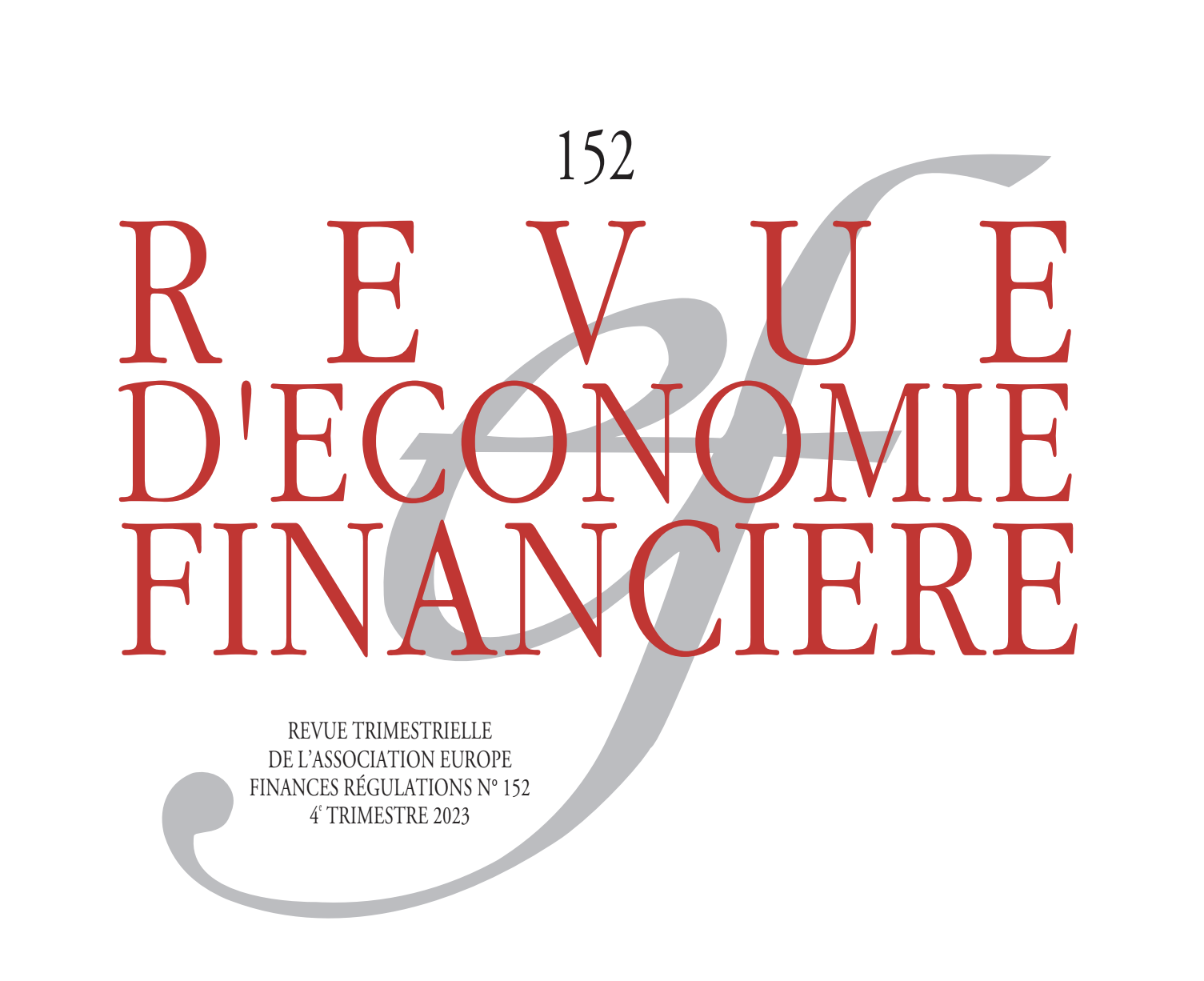
Par Kevin Genna, Chaire TDTE
Pour repousser l’âge moyen d’entrée en dépendance, deux stratégies principales se distinguent, sans qu’elles ne soient exclusives l’une de l’autre. La première stratégie est de revoir notre modèle de santé dans son ensemble afin de mieux traiter la perte d’autonomie. L’expression la plus directe de cette stratégie est d’accentuer les politiques de prévention– relativement à celles curatives –, ce qui permettra alors d’assurer un vieillissement en meilleure santé et donc de reculer l’âge d’entrée en dépendance.
Cette stratégie, très exigeante en moyens de financement, s’applique parfois trop tard dans le parcours de vie des individus et demande un changement considérable, une transformation profonde des institutions, avec les enjeux culturels et de temporalité que cela peut soulever. Nous nous concentrerons donc sur la deuxième stratégie.
Cette deuxième stratégie que nous préconisons consiste à accompagner les individus en leur proposant des dispositifs simples et adaptés à leur situation socioéconomique. Par ailleurs, ils accompagnent les individus tout au long de leurs parcours de vie. Il s’agit là d’une notion essentielle que rappellent les académies de médecine dans leur rapport «Transforming the Future of Ageing » adressé à l’Union européenne : vieillir commence dès la naissance (SAPEA, 2019).
Loin d’un constat défaitiste sur l’inéluctabilité de ce que certains considèrent comme un naufrage, ce rappel des académies de médecine met en évidence, d’une part, que le vieillissement doit être pensé à chaque âge de la vie et, d’autre part, qu’il doit être accompagné d’une évolution des mentalités et des structures sociales pour être réellement efficace. C’est le cas des dispositifs que nous préconisons qui non seulement couvrent toute la trajectoire de vie individuelle, mais aussi sont pensés dans une optique étendue à l’entourage de l’individu, entourage professionnel et social.
La Chaire a amplement démontré depuis plusieurs années tout l’intérêt des activités dites socialisées (humanitaires, culturelles, sportives, syndicales, politiques, etc.) qui sont basées sur le bénévolat et qui amplifient les liens sociaux.
Partager :
Articles liés
14 septembre 2024
Bien-être, activités socialisées et passage à la retraite
Par La Chaire TDTE, UMR et CEPREMAP